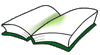Depuis de nombreuses années, la politique française en matière de gestion de l’eau promeut une maîtrise équilibrée et durable de la ressource. On dénombre, en France, près de 34 000 captages d’eau à destination de la consommation humaine. Ces captages permettent de prélever dans les cours d’eau et les nappes souterraines quelques 18 millions de mètres cube d’eau par jour pour alimenter la population. Cette production d’eau potable sur le territoire représente un enjeu de santé publique majeur, il est donc important d’en préserver la qualité.
Depuis de nombreuses années, la politique française en matière de gestion de l’eau promeut une maîtrise équilibrée et durable de la ressource. On dénombre, en France, près de 34 000 captages d’eau à destination de la consommation humaine. Ces captages permettent de prélever dans les cours d’eau et les nappes souterraines quelques 18 millions de mètres cube d’eau par jour pour alimenter la population. Cette production d’eau potable sur le territoire représente un enjeu de santé publique majeur, il est donc important d’en préserver la qualité.
+
-