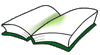Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact

Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (68)
 Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
 Mémoire
Mémoire

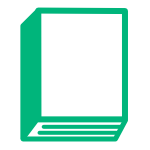
 Livre
Livre978-0-07-100174-8
ISBN : 978-0-07-100174-8 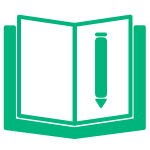
 Thèse
Thèse
 Article
ArticleAquifères : L'Afrique vue de l'espace
in Hydro + , n° 154, 01/06/2005
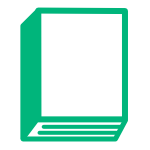
 Livre
Livre92-5-........271 + Annexes p.
271 + Annexes p.ISBN : 92-5-........ 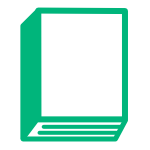
 Livre
Livre978-92-3-202288-2172 p., ref.: *
172 p., ref.: *ISBN : 978-92-3-202288-2 
 Article
Article
 Article
Article
 Autre
Autre
 Autre
Autre
 Article
Article


 Autre
Autre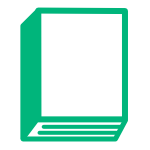
 Livre
Livre978-2-553-00463-6XVIII-365 p.
XVIII-365 p.ISBN : 978-2-553-00463-6 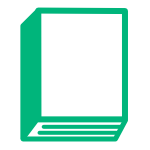
 Livre
Livre978-0-521-47323-1566 p.
566 p.ISBN : 978-0-521-47323-1 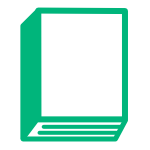
 Livre
Livre978-0-8213-1030-4196 p., ref.: *
196 p., ref.: *ISBN : 978-0-8213-1030-4 
 Mémoire
Mémoire
 Mémoire146 p.
Mémoire146 p.
146 p.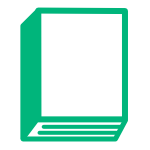
 Livre
Livre
 Article
ArticleFate of nitrogen from agriculture in the southeastern Coastal Plain.
in Journal of soil and water conservation , Vol. 59 n° 2, 01/03/2004

 Article
ArticleFluxes of 13 selected pharmaceuticals in the water cycle of Stockholm, Sweden
in Water Science and Technology , Vol. 63 n° 8, 25/06/2011
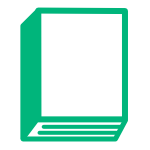
 Livre
Livre