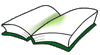Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact

Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (11)
 Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
 Mémoire1 vol. (69 p.)
Mémoire1 vol. (69 p.)
1 vol. (69 p.)
 Mémoire2018 2018109 p.avec annexes
Mémoire2018 2018109 p.avec annexes
109 p.avec annexes
 Article
ArticleBenjamin Coriat : « Essayons les partenariats public-communs ! »
in Horizons publics , n° 21, 02/08/2021



 Mémoire1 vol. (52 p.)
Mémoire1 vol. (52 p.)
1 vol. (52 p.)
 Mémoire
Mémoire
 Mémoire1 vol. (80 p.)
Mémoire1 vol. (80 p.)
1 vol. (80 p.)
 Mémoire2018 201859 p. + annexes 54 p.
Mémoire2018 201859 p. + annexes 54 p.
59 p. + annexes 54 p.
 Article
ArticleDe quoi les tiers-lieux libres et open source sont-ils le nom ?
in Horizons publics , n° 21, 02/08/2021

 Ressource électronique
Ressource électronique